Disparu le 11 juillet 2023 à l’âge vénérable de 94 ans, Milan Kundera a profondément marqué la littérature du siècle écoulé. Nous ne ferons pas l’affront aux lecteurs de Cité de faire « découvrir » l’écrivain tchèque naturalisé français. Cette modeste contribution rédigée à trois mains se veut plutôt une invitation à relire Kundera à travers trois aspects de son œuvre : ses questionnements existentiels, son approche politique et sa contribution théorique à « l’art » romanesque.
N.B. : Présenté aux lecteurs dans son intégralité, cet article a été publié dans le numéro 2024-1 de Cité (Nouvelle Collection n° 5).
Vivre, survivre et revivre : Kundera ou les variations de l’existence
Par Ella MICHELETTI
Milan Kundera a réussi une double prouesse, en apparence contradictoire : celle d’être lu massivement par le grand public et reconnu par le milieu littéraire et universitaire (plus de 450 thèses lui sont consacrées en France), tout en n’ayant jamais reçu le Prix Nobel de littérature. De sa plume alerte et polyphonique, il s’est attelé, durant plusieurs décennies, à engager son expérience personnelle du totalitarisme et des vicissitudes de la vie pour traiter dans ses romans les plus grands thèmes existentiels.
Qui suis-je ?
L’identité, tout d’abord, est un, sinon le sujet omniprésent dans tous les romans de Kundera. Elle se distingue par sa mouvance permanente et un mouvement de fond qui vient la prendre en étau, en fonction des évolutions intimes des personnages et des aléas extérieurs (notamment politiques). Dans L’Identité, l’écrivain interroge par exemple les diverses dimensions de l’être aimé. « Autrui est ce que moi je ne suis pas », comme l’écrivait Levinas, et les liens amoureux sont de perpétuelles « relations avec le mystère ». C’est le cas de Chantal, en couple avec Jean-Marc. Celle qui est une « citadelle de conformisme » dans le cadre de son travail de publicitaire se révèle, dans le privé, un patchwork explosif d’amante amoureuse, de mère peu touchée par la mort de son fils, de libertine… Jean-Marc lui-même est affecté par ce dédoublement identitaire. Capable de grandes envolées lyriques pour envoyer des lettres à Chantal, il fait preuve d’une étonnante froideur alors qu’un de ses amis agonise à l’hôpital.
Kundera cherche à nous montrer que les fréquentations, c’est-à-dire les ajouts extérieurs à la bulle du couple, mais aussi tout simplement le Temps, participent à la mutation de l’identité. Ces multiples facettes peuvent même désarçonner le personnage. Dans La Plaisanterie, Ludvik Jahn, le narrateur, revient dans sa petite ville natale tchèque. Son identité actuelle, qu’il analyse, est remise en question par ce passé qui ressurgit à chaque instant : « Je me mis à surveiller quelque peu mes sourires, et ne tardai pas à déceler au-dedans de moi une mince fissure qui s’ouvrait entre celui que j’étais et celui que je devais ou voulais être. Mais qui étais-je donc en vérité ? À cette question je peux répondre en toute honnêteté : J’étais celui qui avait plusieurs visages. Et leur nombre allait croissant. […] Ce dernier visage était-il vrai ? Non, tous étaient vrais. » Il en arrive à la conclusion qu’il n’est pas un être parfaitement homogène mais plutôt une suite de visages, qu’il peut donner à voir aux autres ou non. Cette question de l’identité et du visage est d’ailleurs judicieusement amenée par Kundera dans L’Immortalité. Le visage, selon l’écrivain turc Ahmet Altan, détermine la conscience de soi, c’est pourquoi tout miroir est interdit dans les prisons de son pays. Chez Kundera, Laura porte des lunettes noires quand elle retrouve sa sœur Agnès. Cet objet suffit à lui-seul à flouter son identité : « Elle ne voyait pas sa sœur, elle voyait les lunettes noires, ce masque tragique qui voulait dicter le ton des retrouvailles. »
Perpétuel exilé
Au-delà des évolutions psychiques intimes, les personnages de Kundera subissent les soubresauts de l’Histoire. L’exil et surtout le retour sont deux éléments extérieurs qui chamboulent l’identité, et qui représentent des thèmes à part entière. Ce choix romanesque est particulièrement observable dans La Plaisanterie qui s’ouvre par ces mots : « Ainsi, après bien des années, je me retrouvais chez moi. » Ce qui est intéressant dans le retour de Ludvik, c’est qu’il semble touché par une anesthésie géographique : « Je ne ressentais nulle émotion […] Des années durant, rien ne m’avait attiré vers ma ville natale ; je me disais qu’elle m’était devenue indifférente. » En traversant le square de cette petite ville, il ressent « une atmosphère de vide poussiéreux ». Plus loin, le lecteur comprend qu’il ne s’agit que d’un réflexe psychologique de survie : « Mais je m’abusais : ce que j’appelais indifférence était en fait de la rancune. » En effet, l’Homme est l’être le moins indifférent qui soit. Il doit se faire violence parfois pour ne pas être noyé par les passions (positives ou négatives), qui se mettent en travers de sa vie. « Il m’était arrivé des choses bonnes ou mauvaises dans cette ville », ajoute le héros. Pour les écrivains qui pour une raison ou pour une autre ont dû fuir une terre, exil et retour vont souvent de pair. Dans ses poèmes, le Palestinien Mahmoud Darwich évoque « l’exil recommencé » et le retour des Palestiniens : « Sous peu, les Palestiniens mettront un terme à cette visite pour entamer leur retour. Ils en finiront avec les périples marins pour faire leurs premiers pas sur la terre ferme. Ils suivront les pas qui, de la migration du sens et de la généalogie, reviennent vers leur première demeure dans la plus ancienne des cités. Elle les autorisera, pour la première fois dans leur histoire contemporaine, à méditer librement sur les signes, sur la différence aussi entre la beauté du mythe et l’ambiguïté du présent, entre le réalisme du rêve et l’absurdité du réel. » Pour le héros de La Plaisanterie, le retour constitue non pas un réel ancrage dans le présent mais plutôt une blessure renouvelée. Il replace Ludvik face à un passé qui a brisé son identité, puisqu’il avait été exclu du Parti communiste, sur dénonciation, après avoir inscrit une phrase humoristique sur une carte pour courtiser une jeune femme (« L’optimisme est l’opium du genre humain ! L’esprit sain pue la connerie ! Vive Trotski ! »). Habité par l’amertume, il ne saura pas saisir l’opportunité de ce retour pour pardonner à celui qui l’a trahi, ce qui l’empêchera d’ouvrir une nouvelle page de sa vie avec une autre femme : « Comment lui expliquer que je peux pas me réconcilier avec lui? Comment lui expliquer qu’en le faisant je romprai mon équilibre intérieur. Comment lui expliquer que ma haine envers lui contrebalance le poids du mal qui est tombé sur ma jeunesse. Comment lui expliquer que j’ai besoin de haïr. »
L’oubli, nécessaire ou dommageable
Cette question de l’oubli, couplée le plus souvent à la mélancolie de l’exil et à l’impossible retour, est essentielle chez Kundera. Le Livre du rire et de l’oubli se présente en sept parties formant un tout autour de ce sujet, ainsi que celui de la mémoire. Il s’agit d’« un roman en forme de variations. Les différentes parties se suivent comme les différentes étapes d’un voyage qui conduit à l’intérieur d’un thème, à l’intérieur d’une pensée, à l’intérieur d’une seule et unique situation dont la compréhension se perd pour moi dans l’immensité ». Tous les récits se rejoignent en la personne de Tamina, une émigrée venue de Tchécoslovaquie et réfugiée en France, qui cherche à raviver les souvenirs autour de son mari décédé, allant jusqu’à se souvenir des petits noms tendres qu’ils se donnaient. Tamina lutte contre l’oubli, le sien, celui de son époux. Dans d’autres parties, Kundera évoque l’oubli progressif de son père en fin de vie ou encore dénonce l’oubli qui frappe la ville de Prague. Il décrit celle-ci en ces termes : « Dans les rues qui ne savent pas comment elles se nomment rôdent les spectres des monuments renversés. Renversés par la Réforme tchèque, renversés par la Contre-Réforme autrichienne, renversés par la Révolution tchécoslovaque, renversés par les communistes ; même les statues de Staline ont été renversées. À la place de tous ces monuments détruits, des statues de Lénine poussent aujourd’hui dans toute la Bohème par milliers, elles poussent là-bas comme l’herbe sur les ruines, comme les fleurs mélancoliques de l’oubli. »
Sexualité et amour
Pour Musset, « les deux grands secrets du bonheur » sont « le plaisir et l’oubli ». Il semble que chez Kundera, cette alliance soit même une question de survie. Car si l’écrivain critique la propension de ces personnages brisés par la vie à évacuer des fragments de leur passé et de leur identité qui les dérangent, il admet également que cet oubli peut les aider à vivre. Ensuite, le plaisir vient en quelque sorte combler le vide existentiel laissé par cette machine à oublier qu’est le cerveau. Les sens prennent le dessus et sont loin de n’être que des échappatoires à la difficile condition humaine. Nombreux sont les personnages de Kundera à trouver un sens et même une ampleur romanesque à vivre par la sexualité et l’amour. C’est le cas de Vincent, le jeune entomologiste de La Lenteur. Le roman entremêle son récit avec celui d’un libertin du XVIIIe siècle, ce qui permet à Kundera de montrer l’intemporalité du désir sexuel. Si l’ouvrage La Lenteur est généralement perçu comme une critique de la vitesse dans une société touchée par « le culte de l’urgence » (Nicole Aubert), il est aussi un véritable ode à la subversion charnelle et une chasse au puritanisme et à l’hygiénisme de notre temps. Le goût prononcé de ce personnage pour la sodomie est décrit de façon crue, libérant brusquement – à la manière d’un George Bataille mais avec une touche d’humour en plus – l’un des fantasmes les plus obsédants d’une partie des êtres humains : « C’est le trou du cul le point miraculeux où se concentre toute l’énergie nucléaire de la nudité. La porte de la vulve est importante (bien sûr, qui oserait le nier?) mais trop officiellement importante, endroit enregistré, classé, contrôlé, commenté […] L’unique endroit vraiment intime, c’est le trou du cul, la porte suprême ; suprême car la plus mystérieuse, la plus secrète. »

Le charme discret de la dissidence
Par Pierre-Henri PAULET
Alors qu’il était encore jeune militant communiste tchécoslovaque, Milan Kundera a été exclu à deux reprises du Parti. Interdit de publication dans son propre pays, il a choisi la voie de l’exil qui était pour lui celle de la liberté de s’exprimer et d’exercer son art. Est-il pour autant devenu un écrivain engagé ? Le mot paraît, le concernant, par trop excessif.
Le romancier a souffert du silence auquel un gouvernement, une idéologie, un système l’ont contraint. Aussi s’attendrait-on à lire sous sa plume philippiques et dénonciations contre le régime qui le priva de sa patrie, de sa citoyenneté – il en fut déchu en 1979 et ne la recouvra qu’en 2019 – ainsi que du droit le plus précieux, celui de faire éditer son œuvre. Il n’en est rien. Il ne s’agissait pas exactement, pour Kundera, d’accepter passivement son sort ou de refouler ses traumatismes ; la coupure avec la terre de ses origines était si vive qu’elle hantera ses écrits. La prudence dont il a fait preuve trouve sa triple justification dans un désabusement (il a cru en la révolution socialiste), une lucidité mélancolique et, enfin, un rapport complexe à l’Histoire. Il ne faut pas s’étonner, dès lors, que Kundera, emblème s’il en est de l’écrivain en exil, ne se soit jamais fendu d’un essai contre le régime communiste. En dépit de la déviation de sa destinée par l’action du politique et de la subversion qu’il représentait pour le pouvoir tchécoslovaque d’alors, il ne fut pas Alexandre Soljenitsyne ni Czesław Miłosz. Rechercher ses convictions profondes entre les lignes, à travers les commentaires de l’auteur omniscient ou les paroles de ses personnages, reste à cet égard un exercice délicat. Pour autant, sa production n’est pas politiquement mutique.
Le drame culturel de l’Europe centrale
Lorsqu’en 2011 la bibliothèque de La Pléiade accueille « l’œuvre définitive » de Milan Kundera, celui-ci a conditionné son autorisation à un véritable droit d’inventaire. À cette occasion il exprime son refus de voir certains de ses textes republiés, notamment ceux qu’il estime de pure circonstance. Parmi eux figure « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale », un célèbre article paru en 1983 dans le vingt-septième numéro de la revue Le Débat. Contribution la plus directement politique de Kundera, elle n’était donc plus considérée par son auteur, quelques trente ans plus tard, comme fondamentale. Le choix est respectable, bien sûr, mais il est quelque peu regrettable, sa relecture étant susceptible d’éclairer jusqu’aux relations actuelles de l’Europe occidentale avec l’Europe centrale et avec la Russie. Ce court article d’une petite vingtaine de pages s’inspire de la déclaration publiée par le directeur de l’agence de presse de Hongrie lors de l’écrasement de Budapest par l’armée soviétique à l’automne 1956 : « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l’Europe ». Milan Kundera explicite la signification profonde de cette affirmation qui, aujourd’hui, n’est pas sans évoquer l’argumentaire de ceux qui estiment le destin de l’Europe lié à celui d’une Ukraine à son tour confrontée à l’assaut russe. Il distingue alors les deux cultures qui ont évolué au sein de l’Europe géographique, « l’une liée à Rome et à l’Église catholique (signe particulier : alphabet latin) ; l’autre ancrée à Byzance et dans l’Église orthodoxe (signe particulier : alphabet cyrillique) ». La Hongrie, à l’instar de toutes les petites nations de l’Europe centrale dotées d’une histoire propre et de particularismes, se rattache à un tradition culturelle, celle de l’Occident. Pour les Tchèques, les Polonais ou les Hongrois, la domination russe représente par conséquent un insurmontable « choc des civilisations » analyse Kundera, en expliquant que « c’est à la frontière orientale de l’Occident que, mieux qu’ailleurs, on aperçoit la Russie comme un Anti-Occident ; elle apparaît non seulement comme une des puissances européennes parmi d’autres mais comme une civilisation particulière, comme une autre civilisation ». Or, la difficulté des Occidentaux à comprendre la disparition de l’Europe centrale réside, pour Kundera, dans le déclassement de la culture européenne, laquelle soudait pourtant l’Europe, à l’époque moderne, après s’être substituée à la religion médiévale. Perspicace, il écrit : « De même que Dieu céda jadis sa place à la culture, la culture à son tour cède aujourd’hui la place ». Ce faisant, il ne répond pas définitivement à la question du ciment de cette Europe actuelle qui aurait liquidé la culture. Mais on jugera de la pertinence des hypothèses avancées : « Les exploits techniques ? Le marché ? Les médias ? […] Ou bien la politique ? Mais laquelle ? […] Est-ce le principe de la tolérance, le respect de la croyance et de la pensée d’autrui ? ».
Bien sûr, Kundera n’avait pas tort, en 2011, de considérer ce texte comme dépassé puisque l’ultime gardienne du temple culturel européen, l’Europe centrale, n’est plus soumise à l’empire soviétique disparu, encore moins à l’idéologie communiste. Elle a même pleinement réintégré l’Europe « déculturée » et désormais unie bon an mal an par… le marché, la technologie, les droits de l’homme. L’actualité politique n’est plus la même, mais cela ne veut pas dire que son auteur a révisé, au début du XXIe siècle, sa réflexion en la matière. Il en reprend en réalité la substance et la précise au détour des réflexions menées dans Le Rideau (2005), confirmant son analyse des « deux Europe », celle du centre ancrée culturellement dans l’Ouest européen, celle de l’Est dominée par le monde russe. Et si les peuples slaves possèdent une parenté linguistique, Kundera nie l’existence d’une culture ou d’un monde slave. Le Russe et le Tchèque sont deux européens, mais ils sont fondamentalement autres. Aussi évoque-t-il une anecdote personnelle : son opposition à la publication de la préface de l’un de ses romans, rédigée par « un éminent slaviste » mais qui plaçait son œuvre en comparaison de celles de prestigieux auteurs dissidents russes. « Non que je ressentisse une antipathie pour ces grands Russes, au contraire, je les admirais tous, mais en leur compagnie je devenais un autre, explique Kundera. Je me rappelle toujours l’étrange angoisse que ce texte m’a causée : ce déplacement dans un contexte qui n’était pas le mien, je le vivais comme une déportation ».
De l’exclusion à l’exil
À défaut de romans engagés, Kundera laisse une œuvre profondément traversée par les chambardements idéologiques de la seconde moitié du XXe siècle. La Plaisanterie (1967) a beau raconter l’histoire d’un amour inaccompli, la toile de fond politique – assez largement autobiographique – envahit tout l’espace. L’existence même du personnage principal, Ludvik, est marquée du sceau de l’infamie qui le frappe lorsque, jeune étudiant, il est exclu de l’Université pour une simple raillerie, au dos d’une carte postale adressée à la fille qu’il aime. En une formule humoristique parodiant Marx, le voilà devenu intellectuel goguenard, et partant ennemi de la construction du socialisme. Sa vie en est durablement affectée puisque, bien des années après, lorsqu’il revient enfin dans la ville de sa jeunesse, la vengeance politique motive ce bref séjour : posséder à tout prix la femme du camarade à l’origine de son exclusion de l’université. Il n’est pas question ici d’idéaux, mais de la politique dans ce qu’elle a de plus dégradant pour l’homme, avec son opportunisme, ses trahisons, ses revirements. Même contraint à une obligation militaire punitive, Ludvik ne renie d’ailleurs pas ses convictions. L’exclusion de la vie intellectuelle tchèque ne fait pas de lui renégat, un dissident effrontément opposé au régime.
Il y a indéniablement chez Kundera, l’homme comme l’artiste, une ambivalence. La tragique affaire Dvořáček, avec ses incontestables zones d’ombre[1], explique peut-être rétrospectivement sa profonde mesure à l’égard des luttes fratricides entre partisans et opposants. Un être qui a connu, de l’intérieur, la mécanique des manipulations politiques évite le piège du manichéisme. En témoignent, dans L’Ignorance (2003) les observations du personnage de Josef : « En août 1968, l’armée russe envahi le pays ; pendant une semaine, les rues de toutes les villes hurlaient de colère. Jamais le pays n’avait été à tel point patrie, les Tchèques à tel point Tchèques […] Quelque quatorze mois plus tard, au cinquante-deuxième anniversaire de la Révolution russe d’Octobre, imposé au pays comme jour férié, dans le bourg où il avait son cabinet, […] il était curieux de voir combien de fenêtres seraient ornées de drapeaux rouges qui, en cette année de défaite, n’étaient que des aveux de soumission ». Dans ce même roman, qui narre le retour à Prague, après l’implosion du régime communiste, de deux exilés du Printemps 1968, Kundera offre une lecture tout en nuances du rapport de ses compatriotes au régime. Ainsi le frère de Josef, pourtant hostile au communisme, a-t-il préféré adhérer au Parti afin de poursuivre son rêve de faire des études de chirurgien, en dépit de ses origines bourgeoises. Contraint de renier ses positions, il se ressent victime tandis que son cadet, l’exilé, est « le petit veinard sachant se tirer de tout ; un déserteur ». Non, la dissidence ne mène pas nécessairement à l’exil et, bien plus encore, l’exilé n’est pas un héros : « [L]a plupart des Tchèques se sentaient comme [Joseph], asservis et humiliés, et toutefois ils n’ont pas couru à l’étranger. Ils sont restés dans leur pays, parce qu’ils s’aimaient eux-mêmes et parce qu’ils s’aimaient avec leur vie qui était inséparable du lieu où ils la vivaient. »
Indéniablement, Kundera n’accorde pas à la succession des régimes et des événements historiques qui passent, s’effacent, muent, se réitèrent aussi parfois avec bouffonnerie, la valeur qu’il concède à l’histoire de l’art. « L’histoire ‘‘tout court’’, celle de l’humanité, est l’histoire des choses qui ne sont plus là et ne participent pas directement à notre vie. L’histoire de l’art, parce qu’elle est l’histoire des valeurs, donc des choses qui nous sont nécessaires, est toujours présente, toujours avec nous ; on écoute Monteverdi et Stravinski dans le même concert », justifie-t-il dans Le Rideau. Il ajoute, enfonçant le clou : « Ce qui restera un jour de l’Europe ce n’est pas son histoire répétitive qui, en elle-même, ne représente aucune valeur. La seule chose qui a des chances de rester, c’est l’histoire de ses arts. » L’engagement véritable de Kundera est un engagement pour l’art, en particulier pour celui qu’il pratique, la littérature, et par-là même de la faculté pour l’homme de pouvoir créer librement. Chez lui, le militantisme strictement politique est étouffé par la résignation, comme chez Leroy, ce trotskyste reconverti en directeur d’agence publicitaire dans L’Identité. « [N]otre siècle nous a fait comprendre une chose énorme : l’homme n’est pas capable de changer le monde et ne le changera pas. C’est la conclusion fondamentale de mon expérience de révolutionnaire. Conclusion d’ailleurs acceptée tacitement par tous », s’exprime ce personnage secondaire du roman. Il ne faudrait pas beaucoup d’audace pour voir apparaître l’écrivain derrière la ligne de dialogue.
Ainsi allait donc l’existence de Milan Kundera, ce dissident discret sinon secret, qui a décliné dès les années 1980 toute proposition d’entretien à la presse. Cet homme qui fut un révolutionnaire idéaliste dans sa jeunesse mais que la « tragédie » de la Tchécoslovaquie a rendu réaliste, ne pouvait que se méfier du politique et de ses contingences. Aussi François Ricard, auteur de la brève préface autorisée à l’édition de la Pléiade, trouve-t-il les mots justes lorsque qu’il relève que « lire un roman de Kundera est toujours une expérience de la désillusion » puisque « la ‘‘vérité’’ dernière de toute aventure, de tout destin, voire de tout désir, est de se découvrir à la fois comme défaite et comme plaisanterie, dans un monde qui n’est plus qu’un immense carnaval de la tromperie, du ‘‘kitsch’’ et de la dévastation ».
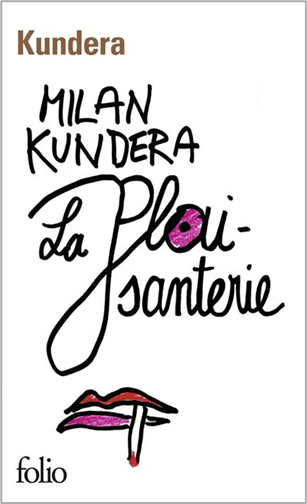
Le roman contre « le monde politisé à l’extrême »
Par Pierre BONNAY
La littérature et l’Europe occidentale chevillées au corps, Milan Kundera a célébré, en quelques ouvrages, discours et préfaces, ce qu’il appelait « l’Art du roman », titre donné en 1986 à son essai le plus célèbre. Pour lui, le roman en tant qu’art littéraire est un corps vivant, mais fragile. D’ailleurs, en évoquant notamment Kafka, Kundera a défendu une certaine idée de la littérature face aux assauts du politique.
Un matin – au sortir d’un rêve agité ? – en janvier dernier, le sociologue Geoffroy de Lagasnerie assura, à l’antenne de France Inter, la promotion de son dernier ouvrage, Se méfier de Kafka (Flammarion). Si le titre était relativement prudent – quoiqu’en langage de clerc, appel à la méfiance vaille souvent anathème – l’auteur offrit une homélie pour le moins iconoclaste. Concrètement, le sociologue s’arc-bouta sur la représentation de l’institution judiciaire, réfutant une vision arbitraire de la justice portée par Franz Kafka, trop influente dans le champ intellectuel selon lui. Son ouvrage, qui se veut notamment une réponse aux travaux d’Adorno sur l’auteur du Procès, relève d’une lecture au premier degré : « Ce qui s’appelle ‘‘La Justice’’ chez Kafka n’a rien de commun avec les dispositifs institutionnels auxquels ce terme renvoie habituellement. »
Ce faisant, Lagasnerie escamote la portée symbolique de l’œuvre kafkaïenne, à savoir les institutions de l’époque post-Révolution industrielle, qui mènent à l’écrasement de l’individu par les poids conjugués de la bureaucratie, de l’anonymisation et de l’automatisation. Pour sa part, observant cet univers, Milan Kundera y voyait « le monde de l’obéissance » et « le monde de l’abstrait » (L’Art du roman). Aussi Lagasnerie ne s’intéresse-t-il pas à d’autres évidences relevées par Kundera chez Kafka, notamment la « manière dont il conçoit le moi » (Id.), alors même que « tous les romans de tous les temps se penchent sur l’énigme du moi » (ibid.). Enfin écarte-t-il l’aspect burlesque d’une œuvre empreinte d’un humour froid, déconcertant, très centre-européen, pour ne pas dire juif : « Le comique est inséparable de l’essence même du kafkaïen », estime Kundera, toujours dans L’Art du roman. Décidément, depuis une position surplombante, c’est-à-dire en tant qu’essayiste défenseur du roman en général, Kundera fait office d’avocat pour Franz Kafka dans ce procès, très méta, qui lui est intenté.
Kafka comme cas d’école
Que reste-t-il de ce furtif épisode éditorial et radiophonique ? Un penseur de la « gauche radicale » entend faire passer l’œuvre de Kafka dans le domaine de l’illicite, ce qui est déjà un événement en soi. Surtout, cette séquence laisse une drôle d’impression d’assiègement, sinon de négation du roman en tant qu’art, par un lettré qui prétend questionner une œuvre sous l’angle de la « représentation », sans réellement appréhender l’exercice romanesque pour ce qu’il est. Coïncidence malheureuse, l’hostilité du sociologue envers le roman kafkaïen s’est déclarée quelques semaines après la mort de Kundera, qui a pratiqué, aimé, explicité l’art du roman, notamment à l’aide de Kafka, mais aussi de ceux qu’il considère comme les fondateurs de cet art : Diderot, Laurence Sterne et surtout Cervantes.
Prenant appui sur ce dernier, Kundera expliquait en 2005 dans Le Rideau que « Don Quichotte est vaincu. Et sans aucune grandeur. Car, d’emblée, tout est clair : la vie humaine en tant que telle est une défaite. La seule chose qui nous reste (sic) face à cette inéluctable défaite qu’on appelle la vie est d’essayer de la comprendre ». Ainsi, la double épopée don-quichottesque définit-elle un principe fondateur de la modernité romanesque occidentale : l’être humain face à ses tourments existentiels. Certes, cela n’est pas un monopole du roman, mais au fil des observations de Kundera – il se présente en praticien et non en théoricien – nous comprenons la singularité de ce genre littéraire.
Nanti d’une ambition qui n’est pas (seulement) celle de décrire le tragique et le sublime, le roman est notamment capable de contourner la tragédie antique, ne serait-ce que par l’antihéros. Dans cette catégorie, on trouve le personnage du déserteur, qui n’est pas celui qui abandonne, mais « celui qui refuse d’accorder un sens aux luttes de ses contemporains » (Le Rideau). Par ailleurs, le roman revêt une forme parabolique qui n’a rien de biblique, bien au contraire, puisque Kundera relève « une incompatibilité sans appel entre le comique et le sacré » (Id.). Il note, à ce sujet, que « les premiers exégètes de Kafka ont expliqué ses romans comme une parabole religieuse. Cette interprétation me semble fausse (parce qu’elle voit une allégorie là où Kafka a saisi des situations concrètes de la vie humaine), mais pourtant révélatrice : partout où le pouvoir […] se comporte comme Dieu, il suscite à son égard des sentiments religieux. » (L’Art du roman). Nous pouvons finalement percevoir en Kafka un exemple type de cet art romanesque décrit par Kundera, dans la mesure où l’auteur du Procès et du Château offre une vision pseudo-sacrée des institutions, en fait désacralisées par l’effet comique de leurs propres outrances et absurdités, tandis que les personnages kafkaïens sont la désertion même, par autodissolution ou par abandon de soi. En outre, ils s’inscrivent pleinement dans un champ littéraire qui conçoit les individus « non pas en fonction d’une vérité préexistante, en tant qu’exemples du bien ou du mal, ou en tant que représentations de lois objectives qui s’affrontent, mais en tant qu’êtres autonomes fondés sur leur propre morale, sur leurs propres lois » (Les Testaments Trahis).
La mort du roman ?
Nous le perdons de vue, tant « roman » et « littérature » se confondent dans le langage courant, mais Kundera nous rappelle que le roman est une séquence de l’histoire de la littérature, et qu’il est mortel. Ainsi écrit-il en 1986 dans L’Art du roman, alors que la Tchécoslovaquie communiste existe encore : « J’ai déjà vu et vécu la mort du roman, sa mort violente (au moyen d’interdictions, de la censure, de la pression idéologique). » De manière générale, sous la plume de l’auteur tchèque, le roman apparaît comme un organisme. Il est un fruit, sinon un outil de l’esprit critique, un enfant de l’Europe moderne où nul écrivain de nulle nation n’éclot sans offrir une variation de ce qui existe déjà : « L’esprit du roman est l’esprit de continuité : chaque œuvre est la réponse aux œuvres précédentes, chaque œuvre contient toute expérience antérieure du roman. » (id.). Sa mort, elle, se déroule par arrêt de l’alimentation : « Nous savons maintenant comment le roman se meurt : il ne disparaît pas ; son histoire s’arrête : ne reste après elle que le temps de la répétition où le roman reproduit sa forme vidée de son esprit. C’est donc une mort dissimulée qui passe inaperçue et ne choque personne. » (Ibid.)
Faire mourir le roman ? Certains semblent y penser à l’intérieur même du cercle des littérateurs, et plutôt dans une perspective politique. Rien de très nouveau pour Milan Kundera : « Si je devais me définir, je dirais que je suis un hédoniste piégé dans un monde politisé à l’extrême », écrit-il en 1980, en préambule de sa pièce de théâtre Jacques et son maître, adaptée du Jacques le fataliste de Diderot. Dans un registre parfaitement opposé, Edouard Louis, ami intime de Geoffroy de Lagasnerie, est l’auteur de récits autocentrés en lesquels il voit un tournant littéraire révolutionnaire. En 2018, interrogé par Libération, il dénonce une certaine tradition fictionnelle : « La bourgeoisie parle toujours de la littérature comme de quelque chose qui sauve, qui ‘‘ouvre les esprits’’, mais dans la plupart des cas, la littérature, c’est une manière d’exclure et d’humilier les dominés ». Au fond, on ignore s’il opère une généralisation maladroite destinée à détacher l’autofiction de son ascendance romanesque – ce qui serait d’autant plus saugrenu que ni Ernaux ni Duras, inspiratrices du genre autofictionnel, ne se sont elles-mêmes créées par génération spontanée – ou s’il fait référence à un kitsch littéraire sur lequel Milan Kundera aurait, lui aussi, beaucoup à dire.
Les essais de l’écrivain tchèque nous rappellent à quel point le roman, non kitsch, peut contredire l’assertion beaucoup trop simple d’Edouard Louis et subvertir son esprit de sérieux. Rappelons-nous ce que Kundera écrivait dans L’Art du roman, comme un principe générique : « L’esprit du roman est l’esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur : « Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses ». En somme, même s’il s’inscrit dans un monde éminemment politique, il demeure l’opposé d’un tract.

Note :
[1] En 2008, le magazine tchèque Respekt a publié un document issu des archives de la police de Prague mettant en cause Milan Kundera dans la dénonciation aux autorités communistes d’un militaire déserteur, Miroslav Dvořáček, qui sera condamné à 22 ans de prison. Si la pièce portant mention du nom de Kundera est authentique, son interprétation est en réalité hasardeuse et la responsabilité directe de Kundera n’est en rien établie.


