Par Ella Micheletti, journaliste.
« Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ? », s’interrogeait saint Marc aux prémices de l’humanité christianisée. Des siècles plus tard, Blaise Pascal se posera peu ou prou la même question : « Que sert à l’homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ? Qui veut garder son âme, la perdra. » Dans une autre variante, Malraux mettra en exergue, au XXe siècle, ce délicat exerce d’équilibriste entre la conservation de notre moi unique – différent d’autrui –, tout en plaidant pour une communion de tous les hommes.
Le point nodal de tous ces réflexions reste le même : nous sommes nés Hommes, dans un monde aujourd’hui soumis à des tumultes sans précédents (notamment la crise climatique et le capitalisme mondialisé), mais comment le rester ? Comment ne pas perdre son âme et surtout son esprit dans un ouragan d’éléments extérieurs qui viennent contrôler et le libre arbitre et même jusqu’à notre possibilité de nous octroyer des respirations existentielles ?
À première vue, depuis la mort des grands intellectuels tels que Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Georg Lukács ou Louis Althusser (plus tardivement), peu de philosophes ont su résister au déclin de la théorie marxiste depuis quarante ans, face à la déferlante néolibérale. À gauche, la chute de l’URSS a entraîné un relatif abandon de la pensée marxiste, en parallèle d’une montée en puissance d’une Seconde gauche anti-totalitaire, à l’origine de nombreux fléchissements néolibéraux en Occident. Quelques personnalités, pourtant, renouvellent puissamment ce courant de pensée et ce depuis des décennies, tels que le sociologue argentin Atilio Borón, le philosophe et sociologue franco-brésilien Mickaël Löwy ou encore le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa. Ce dernier, bien plus jeune que ses deux collègues, occupe une place singulière dans le monde des idées. Né en 1965 à Lörrach, Rosa a écrit une thèse sur la pensée philosophique et politique de Charles Taylor, avant d’être nommé professeur à l’université Friedrich-Schiller d’Iéna et directeur du Max-Weber-Kolleg à Erfurt. Il appartient à la nouvelle génération de penseurs issus de l’école de la théorie critique – dite École de Francfort – au rang de laquelle on a compté non seulement les pré-cités Bloch, Adorno, Lukács mais également le sociologue Erich Fromm, Walter Benjamin ou Jürgen Habermas (deuxième génération).
L’originalité de Rosa tient autant dans ses thèses développées vis-à-vis de la pensée marxiste que dans son succès à grande échelle. Reconnu par ses pairs mais lu par un public plus large que certains de ses prédécesseurs, il se distingue par sa visibilité dans des médias et sa pédagogie de forme au service d’un fond rigoureux voire difficile à appréhender pleinement. Le présent article n’a pas prétention à couvrir de façon parfaitement exhaustive l’ensemble de sa pensée dans ses moindres recoins, comme une thèse aurait vocation à le faire. Néanmoins, passons-en en revue – attentivement – les grandes lignes.
Repenser l’aliénation
Qui dit point de départ dit point de friction pour le bonheur humain. Rosa fait le constat que les individus qui vivent l’ère post-moderne, dans un monde régi par le capitalisme mondialisé, se trouvent globalement dans une situation et une position d’aliénation, cette dernière étant comprise comme un outil de désintégration de ce qu’il appelle « une vie bonne » (tout en s’interrogeant ce qu’elle peut contenir). Pour rappel, Karl Marx, dans L’Idéologie allemande, définit l’aliénation comme le fait, pour un ouvrier, de se voir devenir étranger : au fruit de son travail dont il est privé, dans son identité au sein d’une entreprise pour laquelle il n’est qu’une source productive et aussi dans ses rapports avec les autres hommes. Chaque humain assiste à une déshumanisation de ses liens avec autrui, au sein d’un système basé sur l’échange de produits.
Dans son ouvrage Aliénation et accélération – vers une théorie critique de la modernité tardive1, Hartmut Rosa explique que son but est « de rétablir un concept bien plus ancien de la Théorie critique, développé par Marx et l’École de Francfort à ses débuts mais abandonné tant par Honneth que par Habermas : le concept d’aliénation ». Selon lui, l’aliénation de l’individu contemporain est massivement due à une accélération protéiforme de sa vie et de la société. « J’entends montrer que dans sa forme présente, ‘‘totalitaire’’, l’accélération sociale mène à des formes d’aliénation sociale sévères et observées empiriquement, qui peuvent être vues comme le principal obstacle à la réalisation de la conception moderne d’une ‘‘vie bonne’’ », ajoute-t-il en propos liminaire.
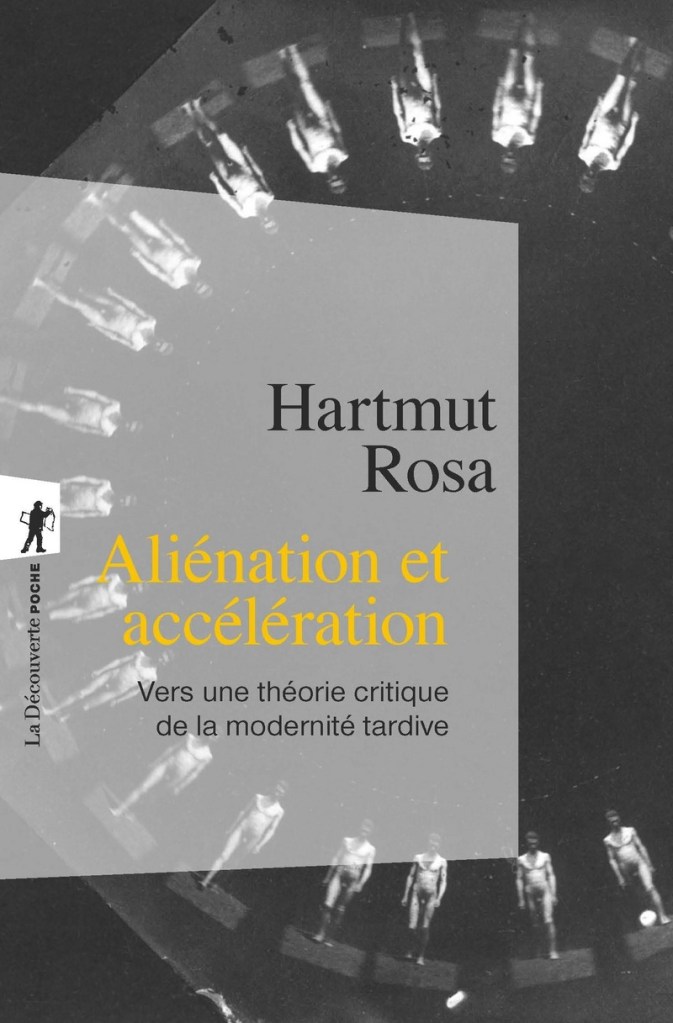
Mais en quoi sommes-nous aliénés ? Vis-à-vis de qui, de quoi ? Le philosophe a discerné trois facettes de notre être aliéné dans la société actuelle. Tout d’abord, l’aliénation par rapport à l’espace. Toujours dans Aliénation et accélération, Hartmut Rosa part là encore d’un fait aisément observable : « À l’âge de la mondialisation numérisée, la proximité sociale et la proximité physique sont de plus en plus séparées : ceux qui sont proches de nous socialement n’ont plus besoin d’être proches de nous physiquement, et vice versa […] Tout cela n’implique pas nécessairement l’aliénation par rapport à l’espace mais cela la rend possible. » Et de citer l’exemple éloquent de directeurs d’hôtels qui témoignent des appels de leurs clients demandant « dans quelle ville ou dans quel pays ils se trouvent ». En sachant que, comme l’affirme Rosa, tout humain a ce besoin intemporel d’un « chez soi », comme retrouver une connexion à l’intime d’un espace, dans un monde à la mobilité accrue et à la virtualisation constante ? L’auteur emploie le terme allemand Heimat qui signifie que « nous sommes intimes d’un certain espace ». La création de ce lien devient de plus en plus rare quand des individus déménagent souvent. Si, comme le montre Rosa, les nouveaux habitants déterminent rapidement, pour des raisons pratiques, la localisation de certains lieux (supermarché, médecin, salle de sport), ils n’occupent pas les espaces entre ces lieux. L’occupation est désincarnée. Pourquoi ? Car une telle occupation « demande du temps ». Et le temps, c’est précisément ce qui manque cruellement à tout un chacun.
Ensuite, nous subissons une aliénation par rapport aux choses. Le fait peut sembler paradoxal tant nous cohabitons avec une somme astronomique d’objets et d’outils à portée de main, du moins dans les pays occidentaux. Rosa le reconnaît : « Nous sommes déjà entrés dans l’espace des choses […] Les êtres humains, selon moi, ont toujours des relations intimes et constitutives avec au moins certains objets. En fait, les choses avec lesquelles nous vivons et travaillons sont dans une certaine mesure constitutives de notre identité. » Cependant, cette relation aux objets est traversée par le consumérisme qui touche la quasi-totalité d’entre nous, à différents degrés. Pour le dire autrement – et Rosa fournit de nombreux exemples – nous investissons pleinement un objet quand nous le gardons, le touchons, le réparons, quand il nous accompagne à divers moments de notre vie. Dans ce cas, il y a « de grandes chances qu’ils deviennent une partie de vous-mêmes ». Les choses deviennent « partie intégrante de votre expérience vécue quotidienne ». Le problème est que nous avons tendance de plus en plus à jeter plus qu’à réparer, à remplacer un objet pour un modèle supérieur sans réelle utilité, ce à des fréquences de plus en plus rapprochées. Selon une enquête d’Iligo2 une agence d’études dédiée à la compréhension des comportements de consommation, datée de 2022, « les Français sont aussi davantage à déclarer aimer les technologies de pointe (86 % en 2022 contre 52 % en 2015) ». Et il n’est même plus possible de plaider pour une fracture générationnelle puisque les plus âgés rejoignent les plus jeunes dans ce mouvement. La gadgétisation du monde entraîne forcément une redéfinition du rapport aux choses, étrangement plus complexe. En effet, à mesure que les technologies deviennent plus pointues, les utilisateurs perdent de plus en plus le contrôle desdits objets, faute de pouvoir acquérir les connaissances et codes suffisants. Rosa explique ainsi qu’il savait changer la sonnerie de son ancien téléphone et qu’il peine pour le nouveau. Les gadgets sont créés en vue d’être insaisissables pour l’Homme et c’est également ce qui les rend attractifs car mystérieux. Idem pour l’utilisation d’un nouveau logiciel, puis d’un autre, puis d’un autre. « Le nouveau logiciel et moi, nous devons véritablement aliénés l’un à l’autre », estime le philosophe.
Le dernier cas d’aliénation est lié à nos actions. Pour Hartmut Rosa, il découle en partie de la seconde aliénation par rapport aux objets. « Nous ne trouvons jamais le temps de nous informer réellement au sujet des choses qui sont sur le point de nous concerner », comme la lecture de contrats, les notices de médicaments, les manuels que nous consultons, le tout à cause d’une surcharge d’informations. Idem pour les « grands choix de vie ». Les guides écrits censés aider les lycéens à opter pour telle ou telle formation dispensent « le même conseil candide : Premièrement, déterminez ce que vous souhaitez faire exactement et ce dont vous avez besoin pour y arriver. Puis étudiez attentivement les brochures et programmes disponibles des universités… » Nul besoin d’aller plus loin pour comprendre que le bât blesse dans cette pression, cette quasi instantanéité à laquelle nous sommes soumis dans nos choix, ce qui entraîne à l’évidence des choix par défaut, surtout à des âges où nous aspirons à être pluriels.
De ces situations observées par Rosa dans le quotidien d’une grande partie des peuples occidentaux surgit une question-phare : pourquoi sommes-nous ainsi aliénés ? Réponse (non exhaustive) : notamment car nous subissons une accélération sociale du temps, nette, névrotique, bien loin d’un simple ressenti ponctuel et minoritaire, comme les magazines et les médias le suggèrent parfois.
L’accélération protéiforme
Bien entendu, Hartmut Rosa ne pratique pas la magie : « Une heure est une heure et une journée est une journée […] et il est évident que les grossesses, les grippes, les saisons et les temps de l’enseignement n’accélèrent pas. » De même, il préfère parler d’un ensemble de phénomènes d’accélération sociale du temps plutôt que d’un unique processus monolithique qui viendrait toucher nos sociétés.
L’accélération technique est la plus flagrante à première vue. C’est aussi la plus « facilement mesurable » d’après l’auteur car elle se voit dans le domaine des transports, de la communication et de la production. Ainsi, la vitesse de communication a-t-elle augmenté de 107 %, celle des transports de 102 % et celle de la vitesse du traitements de données de 1010 %. Rosa reprend à ce niveau le concept de « dromologie » du philosophe et architecte Paul Virilio qui estimait que ce processus d’accélération avait d’abord touché les transports puis les transmissions et que le prochain stade (à son époque) serait celui des biotechnologies, auquel nous sommes confrontés. Résultat de cette accélération technique, « l’espace, à bien des égards, perd de son importance pour l’orientation dans le monde de la modernité tardive. Les activités et les développements ne sont plus localisés et les endroits réels tels que les hôtels, les banques, les universités ou les centres industriels tendent à devenir des ‘‘non-lieux’’, c’est-à-dire des endroits sans histoire, sans identité et sans relation ».
L’accélération du changement social, quant à elle, concerne, l’explique Rosa, une accélération non pas à l’intérieur d’une société, comme c’est le cas des transports dans tel pays, mais d’une accélération d’une société elle-même. Les exemples sont légion : « Les attitudes et les valeurs autant que les modes de vie, les relations et obligations sociales autant que les groupes, les classes, les milieux, les langages sociaux autant que les formes de pratique et les habitudes changent à des rythmes en constante augmentation. » Les habitants des sociétés occidentales contemporains subissent de plus une « compression du présent », aussi appelée en allemand Gegenwartsschtrumpfung et développée par le philosophe Hermann Lübb. En d’autres termes, leur présent se retrouve tassé et concentré à la suite de l’accélération des vitesse d’innovation culturelle et sociale. Lübbe insiste sur le fait que « ce qui n’a plus cours/n’est plus valide tandis que le futur dénote ce qui n’a pas encore cours/ce qui n’est pas encore valide ». Rosa, de son côté, montre que l’accélération du changement social a été particulièrement visible au niveau du travail. Pendant des siècles, dans les sociétés pré-modernes, le métier était exercé de père en fils ; dans la société moderne (entre 1850 et 1970), les métiers avaient tendance à changer avec les générations ; dans la modernité tardive, les métiers changent à un rythme plus rapide que les générations. Un employé américain ayant fait des études supérieures changera environ onze fois de travail au cours de sa vie, selon les études de l’historien Richard Sennett.
Enfin, l’accélération du rythme de vie, intimement liée aux deux autres accélérations, est celle que Rosa qualifie de « famine temporelle ». Les individus n’avaient jamais autant ressenti « qu’ils manquent de temps et qu’ils l’épuisent. C’est comme si le temps était perçu comme une matière première consommable telle que le pétrole et qu’il deviendrait, par conséquent, de plus en plus rare et cher. » Néanmoins, il ne s’agit pas d’un simple ressenti qui n’aurait aucun fondement rationnel. Outre l’impact de la révolution numérique, l’instantanéité des échanges, les individus sont soumis, comme l’explique la sociologue Nicole Aubert, à « un culte de l’urgence ». Rosa rappelle également que les études sont claires : nous dormons moins, avons tendance à manger plus vite et à communiquer paradoxalement moins avec nos proches que ne faisaient réellement nos ancêtres. Ces données doivent toutefois être prises avec des pincettes car des évolutions « inverses » les contredisent. Par exemple, il est certain que les pères d’aujourd’hui, du moins dans les sociétés occidentales, passent beaucoup plus de temps avec leur progéniture.
Cette « famine temporelle » peut sembler contradictoire avec l’accélération technique, qui devrait permettre de « gagner du temps ». Mais l’accélération des techniques, du rythme de vie et des changements sociaux ne fait en réalité pas gagner de temps, explique Hartmut Rosa. Le temps réellement libre n’augmente pas car les minutes supposément gagnées en répondant par un mail – rapide – plutôt que par une lettre manuscrite – comme il y a soixante ans – sont immédiatement remplies par d’autres tâches, de nouvelles tâches, qui créent un lissage des priorités. Tout devient urgent et prioritaire, en somme.
Au vu de ces nombreux éléments, il est intéressant de se rappeler les propos de Baudelaire qui à son époque (XIXe siècle) souhaitait « tuer le temps qui a la vie si dure et accélérer la vie qui coule si lentement ». La société occidentale du XXIe siècle est au contraire engloutie dans une spirale de vitesse où même l’idée de « gagner du temps » devient un objet marketing des acteurs néolibéraux, à grands renforts de guides, de conseils, voire de formations (hors de prix) pour apprendre à prendre son temps. Le résultat reste toujours une compartimentation rigide de notre vie et une incapacité à se laisser vraiment aller. Pourquoi ? Car ces multiples accélérations ne glissent pas sur les individus comme la pluie sur les plumes d’un canard. Nous ne rentrons pas chez nous le soir entièrement dépouillés des urgences de la journée. Les « coupables » sont aussi nombreux que difficilement modifiables à court terme : la compétition instaurée par la génération du système capitaliste et néolibéral, le new public management, le culte de la productivité, le désir mégalomane des hommes de gagner du temps sur la mort, etc.
On pourrait en conclure que le manège n’en finit jamais de tourner, au risque de donner le vertige à tous. Comment y mettre un coup d’arrêt ? Comment suspendre, souffler ?
Alors… décélérer ?
Hartmut Rosa met en avant plusieurs types de décélérations, là encore observables dans notre société. Des individus ou des groupes tentent, consciemment ou inconsciemment, de freiner la machine, au moins temporairement, et avec des résultats mitigés. Mais parfois, ce sont les éléments eux-mêmes qui imposent une décélération. Ce sont les limites de vitesse naturelles et anthropologiques, comme la grossesse, les maladies (les tentatives pour faire passer très vite des rhumes et grippes sont généralement vaines), le cycle d’une journée et d’une nuit (basé sur des événements astronomiques).
Il existe ensuite ce que le philosophe appelle des « oasis de décélération » : certaines « niches » territoriales, sociales et culturelles n’ont pas encore été « touchées par la dynamique de la modernisation ». Il s’agit de tribus retirées, de groupes tels que les Amish, etc. Leur retrait tend pourtant de plus en plus à s’éroder, la modernisation vorace étant par nature extensive et intrusive. Ces îlots en viennent même parfois à devoir être protégés activement contre l’accélération, par des lois ou actions collectives.
Par ailleurs, la décélération peut être involontaire, en ce qu’elle va advenir en cas de dysfonctionnement de l’accélération sociale, la forme la plus connue, selon Rosa, étant l’embouteillage. Le chômage de masse, où des travailleurs sont exclus des sphères de production souvent en raison de leur incapacité à s’adapter aux besoin de flexibilité, peut aussi être perçu comme une décélération extrême.
S’agissant de la décélération intentionnelle, elle peut être active et individuelle, comme par exemple quand des cadres effectuent des retraites dans des monastères mais le but véritable est de revenir plus performant et revigoré que jamais. En revanche, certains mouvements sociaux prônent à plus grande échelle une décélération radicale, « dont les traits sont assez fréquemment anti-modernistes », selon Rosa. D’après lui, tout appel à décélérer ne doit pas être réduit à sa dimension idéologique. En effet, il est fort probable que les circonstances actuelles et futures entraînent de façon inévitable une décélération économique.
Mais en attendant de voir surgir ou progressivement advenir un changement de système qui se déroulera peut-être sur plusieurs générations, Hartmut Rosa émet une proposition profonde et même existentielle, celle de la « résonance » au monde. Pour pouvoir appréhender au mieux ce concept, il est nécessaire de comprendre avant tout celui « d’indisponibilité » de ce même monde.
L’indisponibilité du monde
« La pire difficulté pour l’individu créateur, c’est de réfréner l’entêtement à vouloir catégoriser le monde à son image », a écrit Henry Miller. Cette idée ne peut-elle pas être appliquée à tout individu, encore plus celui qui vit dans une société post-moderne et mondialisée ? Et osons aller plus loin : loin de vouloir se cantonner à une simple catégorisation du monde, l’Homme du XXe siècle (et dans une certaine mesure du XIXe avant lui) a tenté de contraindre le monde, de le saisir entièrement. La différence avec un homme du XVIIIe réside notamment dans l’immense avantage technologique mais les racines de l’humanité convergent depuis toujours en une certitude de la spécificité que les humains ont vis-à-vis des autres animaux. Le mythe de Prométhée défiant les Dieux et par ricochet un ordre gigantesque ne dépendant pas de lui, un ordre étranger à lui, a connu des variantes aux quatre coins du globe. Il est vrai que nous ne connaissons pas le mythe d’Amiran, ce titan ayant défié Dieu, son parrain, et ayant été condamné à l’enchaînement éternel au sommet du mont Gerget’i. Mais cette histoire et celle de Prométhée sont suffisamment éloquentes pour donner à comprendre l’idée générale de dépassement qui touche notre espèce. Dépassement de ses congénères, dépassement des éléments naturels, dépassement des autres êtres vivants, avec pour justification sa différence que personne, à part des militants antispécistes, ne saurait remettre en question.

Dans son ouvrage Rendre le monde indisponible3, le philosophe repère quatre dimensions dans notre tentative de maîtrise du monde. D’abord, rendre connaissable/visible ce qui existe. Avec les télescopes et les lampes, le ciel et le monde de nuit nous sont disponibles désormais. Puis, rendre cet existant atteignable et accessible. Les fusées permettent par exemple d’aller sur la lune et les satellites de nous connecter à un cosmos lointain, tout comme les sous-marins de pointe accèdent aux mers profondes. Liée à cette seconde dimension, la troisième consiste à rendre maîtrisable ce qui a été décelé et mis en lumière. Il s’agit « de mettre sous contrôle un fragment du monde ». Exemple en est du colonialisme, composé d’un ensemble d’actions (voyages et tueries) mais aussi de production de savoir (avec les cartes) et de maîtrise politico-militaire (qui a permis de décimer des sociétés qui n’avaient pas les mêmes moyens). Enfin, dernière étape : rendre utilisable et mettre en service ce qui a été acquis, « en faire l’instrument de nos fins, ce qui transforme la mise à disposition du monde en mise en forme et production du monde », précise Hartmut Rosa. La thèse de ce dernier à ce sujet est originale : d’après lui, plus nous avons concrètement conquis des fragments du monde, plus celui-ci s’est révélé mystérieux, insaisissable, toujours indépendant de notre sentiment de contrôle total (notamment en cas de catastrophes naturelles). Pire, il semble être ce que nous en avons fait, à savoir une terre en sursis, dont les colères (la crise climatique) semblent autant de menaces à notre égard que de conséquences de nos actions mégalomanes et irréfléchies. Nous avons cru « prendre » à l’infini sans nous laisser prendre. Rosa évoque « un recul énigmatique du monde ». Le philosophe cite l’exemple d’un entretien donné par Erhard Eppler (1926-2019), membre du Parti social-démocrate d’Allemagne et ancien ministre de la Coopération et du Développement. L’homme politique raconte le grand défrichement, en Afrique du Nord, de forêts auquel il assisté depuis un avion, dans le but de trouver des terres fertiles. Ironie du sort : la terre fertile a été « emportée par les pluies et a laissé, dit-il, un gigantesque tapis brun devant l’embouchure du fleuve se déversant dans la mer ». « Le fragment du monde exploité » est ainsi devenu « dur et stérile et, dans ce sens, pratiquement hostile », remarque Rosa.
Dans une société où nous subissons des sommes astronomiques de sollicitations, on pourrait croire que l’Homme recherche un silence bienfaisant. Cela ne veut pas dire que nous recherchons le mutisme du monde, son rejet de nous-même. Rosa l’affirme : nous sommes bien tous au monde. Mais de quelle façon souhaitons-nous l’être ? Dans un rapport de constante agression de tout ce qui peuple la terre ? Nous serions loin dans ce cas de mener une « vie bonne » comme peuvent l’entendre une majorité d’individus.
Entrer en résonance
Hartmut Rosa refuse toutefois de se laisser aller à un pessimisme intégral. Son concept de « résonance » pourrait être parfaitement illustré par ces mots de Jean-Jacques Rousseau : « L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie. » Dans Oblomov de Gontcharov, le personnage d’Olga utilise le verbe « sur-vivre » pour caractériser son désir de vivre plus intensément, plus profondément, contrairement au héros qui sous-vit et finit par en mourir.
Dans son ouvrage Résonance, une sociologie de la relation au monde4, Rosa définit ainsi son concept comme étant « le résultat et l’expression d’une forme spécifique de relation entre deux entités, en particulier entre un sujet de l’expérience et des fragments du monde qui viennent à lui. » En des termes plus profanes, cette résonance peut être comprise comme une sensibilité accrue et surtout sincère envers notre environnement, comme une ouverture par une plus grande évocation des sens (regarder un paysage et non le voir, écouter le chant d’un oiseau, même quelques secondes et non pas le laisser constamment en arrière-fond de notre vie, sourire à un inconnu plutôt que baisser la tête). La résonance est loin d’être passive en ce qu’elle suppose « l’éclair d’un espoir d’assimilation et de réponse dans un monde qui se tait ». Et qui dit sensibilité à la résonance dit sensibilité à l’aliénation. Des blessures ou conflits ne naît pas forcément une carapace de dureté mais au contraire une plus grande empathie. C’est la « corde vibrante reliant un sujet et le monde », ou un sujet et un autre sujet, qui peut être nourrie et évoluer car « les relations au monde sont toujours dynamiques ». Rien d’inné ou presque dans cette capacité à entrer en résonance. D’ailleurs, Rosa, citant le philosophe marxiste Herbert Marcuse, rappelle que « la société capitaliste libéralisée et répressive […] produit entre l’homme et le monde une aliénation fondamentale », qui touche toutes les sphères de nos vies. Le cas de l’amour et de la sexualité est un bon exemple. À l’heure de la généralisation des applications (70 % des rencontres se font ainsi), le risque est grand de voir se développer une sexualité mécanique et désérotisée. Le « coup de foudre », les palpitations, Frédéric touchant le poignet de Madame Arnoult chez Flaubert, une femme dansant brièvement avec un homme dans La foule d’Edith Piaf… La littérature et les autres arts regorgent d’histoires montrant le potentiel érotique de toute rencontre physique. S’inspirant toujours de Marcuse, Rosa avance qu’il est tout à fait possible de « vivre une sexualité sans résonance » dans une société « hypersexualisée où les énergies libidinales peuvent être rapidement évacuées sous forme pornographique ou dans d’autres actes sexuels non résonants ». L’amour, quant à lui, est intrinsèquement une résonance entre deux sujets et aussi entre les sujets et le monde extérieur, « celui qui est amoureux se trouve placé dans le monde d’une manière entièrement nouvelle car il dispose à présent d’une corde vibrante qui le relie au monde ».
Autre exemple de résonance, tout aussi universel : le désir de laisser une trace dans le monde. Hartmut Rosa montre que la création artistique, le couple, l’enfantement, sont autant de moyens de « laisser sa trace de son passage dans le monde et de marquer une différence ». « La procréation, en ce sens, est aussi une production de monde », ajoute-t-il. De là à conclure à l’existence d’une nature humaine, il n’y a qu’un pas. Car si les autres animaux laissent une trace, ils ne sont pas animés du même désir de reconnaissance. Certains sont même de parfaits solitaires la plupart du temps. Cultiver la résonance au monde, pour l’Homme, serait donc un moyen parmi d’autres de confirmer cette pensée très juste et intemporelle d’Octavio Paz : « La solitude est le fond ultime de la condition humaine. L’homme est l’unique être qui se sente seul et qui cherche l’autre. »
- Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, La Découverte, 2012, 143 pages. ↩︎
- « Les Français sont tous devenus accros à la Tech… », 12 mai 2022, https://comarketing-news.fr/les-francais-sont-tous-devenus-accros-a-la-tech/ ↩︎
- Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible, La Découverte, 2020, 161 pages. ↩︎
- Hartmut Rosa, Résonance, une sociologie de la relation au monde, La Découverte, 2018, 718 pages. ↩︎


